Les Oublié·es ne rentrent dans aucune case. Jugées trop jeunes ou trop vieilles, elles ne peuvent être accueillies et accompagnées dans les structures de soins telles qu’elles sont organisées aujourd’hui. Lors d’une matinée de réflexion, le Collectif Place des aînés ne s’est pas fait prier pour porter sa voix. Et nous, on a savouré cette prise de parole franche et pleine d’humour qui informe et bouscule, sur cette question de société : « quand on vieillit, qu’est-ce qu’on devient ? Où va-t-on ? »
Par Stéphanie Devlésaver, journaliste, CBCS – avril 2025
Depuis 2020, un petit alinéa a été ajouté à la convention qui régit l’organisation des Centres de jour : une norme en limite l’accès pour les « plus de 67 ans ». Un détail, diront certain.es… « Moi ça me choque ! C’est discriminatoire ! », s’exclame le plus jeune représentant du groupe Place des Aînés. C’est en découvrant l’existence de cette norme, il y a un an, que des patients et ex-patients d’un même centre de jour ont décidé de se réunir en collectif. « T’imagines, du jour au lendemain, on ne voit plus Marcel ou Josette parce qu’elle ne serait plus autorisée à venir ? Ils et elles apportent du dynamisme, ont l’expérience, la connaissance ». Pour le jeune homme, c’est simple, « on a besoin de nos aînés » ! Au-delà de la plus-value intergénérationnelle, la question est aussi : « où va-t-on après ? » : « sans structure, isolée socialement, tu dépéris ! »
Quand le Collectif se penche sur d’éventuelles alternatives, elles ne se battent pas au portillon… « Les lieux de liens, c’est sympa, mais c’est surtout assumé par des bénévoles. Du coup, ça change souvent. Cela manque de suivi dans les activités, l’accompagnement social et psychologique. Et si un jour, tu ne viens pas, qui s’en préoccupe ? »… « Relégué·es en maison de repos ? En centre pour seniors ? Si tu es encore bien, pourquoi aller dans un lieu où on est des assisté·es ? », s’interroge le groupe.

« Ce passage [entre chez soi et une MRS] est un moment crucial », souligne Damien Hombrouck, psychologue (Cliniques Saint-Jean, Valida), qui nécessite un travail psychique avec les personnes pour recréer quelque chose d’un chez-soi, au risque d’être, comme lui confiait l’une de ses patientes récemment entrée en MRS avec son mobilier, « comme une étrangère entourée de ses propres meubles ». Le grand âge est multiple, ajoute-t-il, « il y a autant de façons de prendre soin qu’il y a de personnes âgées », ce qui implique de promouvoir l’accueil, de diversifier les pratiques, de mettre en avant les compétences propres de chacun·e des soignant·es…
Encore faut-il avoir les moyens humains et financiers pour assurer cet accompagnement sur mesure. Or, dans les échanges de la matinée, différents professionnel·les du soin dénoncent « le manque de budget et les normes qui ne permettent pas de penser le lien, mais exigent d’être sans cesse dans l’action ». [1]Infor-Home insiste sur la taille et le nombre de résident·es dans les MR/MRS – « il y a actuellement moins de maisons de repos, mais de plus grande capacité qu’avant ». Quant aux coûts, ils pèsent à la fois du côté des institutions pour répondre aux normes liées à leur agrément, mais aussi du côté des résidents : « la majorité des personnes n’ont pas 1500 euros par mois pour payer leur loyer en MRS ! ». Et ce, malgré une réforme globale du secteur des établissements pour aînés initié en 2024 qui s’accompagne d’une augmentation de l’encadrement des habitants en termes de personnel et d’une révision des modalités de contrôle des établissements dans une logique d’accompagnement.

Dans une publication des Céméa (2021), la sociologue Sylvie Carbonnelle insistait sur cette difficulté à s’inscrire dans un autre paradigme du soin en Belgique où le modèle médical est encore largement dominant (diverses études montrent que les personnes âgées en institutions sont surmédiquées) : « même si on reparle aujourd’hui de petites unités de vie, les normes institutionnelles sont très rigides (d’hygiène, architecturales…), ce qui fait que des dimensions essentielles de la vie sont un peu oubliées ».
La sociologue dénonce la manière dont le care est trop souvent pensé dans les institutions pour personnes âgées et les politiques publiques : « C’est un care de la dépendance qui réduit encore trop souvent l’accompagnement de la personne âgée à une « prise en charge » extrêmement formatée, dûment mesurée et financée : « Les individus ne sont pas des numéros mais des grades sur une échelle de dépendance. On ne considère pas les gens dans l’épaisseur de leur existence ».
« C’est un care de la dépendance qui réduit encore trop souvent l’accompagnement de la personne âgée à une « prise en charge » extrêmement formatée, dûment mesurée et financée »
Sylvie Carbonnelle, sociologue
Et puis, il y a cette idée de « tout cloisonner » qui nous fait horreur, poursuit le Collectif Place des aînés, « C’est la rencontre, le contact entre les générations qui sont vivifiants. Sans jeunes, cela devient un ghetto de vieux et sans anciens, cela devient un ghetto de jeunes et tout l’écosystème est perturbé ». Cet écosystème, c’est justement ce qui permet à des dispositifs tels que les Centres de jour d’exister : « tu es vraiment quelqu’un, tu fais partie de la famille, on appartient à une communauté, les autres peuvent aussi compter sur toi ». Les Centres de jour, à travers un travail thérapeutique ancré dans la vie communautaire, le tissage de liens, chacun·e à sa mesure, relèvent, à leur manière, le défi de continuité, souligné par Sylvie Carbonnelle, celui de « soutenir autant que faire se peut l’ existence telle qu’ils-elles la souhaitent. […] Tenez compte de leur passé, de leurs attachements, ne faites pas à leur place, n’imposez pas d’activités d’animation complètement formatées, insiste-t-elle… Il importe de permettre un maintien identitaire, des relations sociales à l’intérieur comme à l’extérieur, de cultiver le goût de vivre… ».
Alors, y aurait-il un meilleur âge limite pour basculer vers d’autres dispositifs ? Quand est-ce qu’on est vieux ?… Non, « ce n’est tout simplement pas une question d’âge ! », s’exclame le Collectif. « Tant qu’on est prêt à progresser et prendre part, pourquoi faudrait-il nous arrêter ? Ou nous refuser l’accès sur base de notre date de naissance… Ou de péremption ? ». Les représentations occidentales de la vieillesse oscilleraient entre la figure du « senior indépendant et actif » d’une part, et celle du « vieillard dépendant et apathique » d’autre part. Or, cette polarisation caricaturale toujours prégnante tend à dissimuler la diversité des formes que prend la vieillesse. (Jumeaux-Bekkouche Sophie, Caradec Vincent, « Sociologie de la vieillesse et du vieillissement. Domaines et approches », 2012).
« Tant qu’on est prêt à progresser et prendre part, pourquoi faudrait-il nous arrêter ? Ou nous refuser l’accès sur base de notre date de naissance… Ou de péremption ? »
Le Collectif Place des Aînés
« C’est révoltant, les ministres, les présidents, eux, ils peuvent travailler jusqu’à 70, 80 ans, même quand ils n’ont plus leur tête ! Et personne ne discute ! Et qui sait, ils auront peut-être besoin d’un centre de jour ! », ironise encore le Collectif. Avec raison, puisqu’il « n’y a pas de définition arrêtée de ce qu’est une personne âgée ou « vieille », assure Sylvie Carbonnelle. Elle préfère d’ailleurs parler de « personnes vieillissantes (comme en anglais ageing people), évoquant un « processus d’avancée en âge », parce qu’il n’y a pas d’âge fixe, pas de seuil déterminé à partir duquel on devient âgé, vieux ou vieille ».
Si ce n’est pas une question d’âge, ce serait donc plutôt une question d’autonomie, au sens « d’espace pour choisir, décider et prendre des initiatives », comme la définit Myriam Rasse, psychologue clinicienne en crèche et pouponnière. Selon elle, c’est d’ailleurs « valable pour les jeunes enfants comme pour les personnes âgées ou en situation de dépendance en général : pouvoir décider dans le soin ».
Alors, à quand un autre regard pour prendre soin de tous les âges de la vie ? Pour laisser de l’espace pour le développement ou le maintien d’une certaine autonomie ? Pour financer l’autonomie plutôt que la dépendance ?… Qu’on se le dise, le chemin est long et intimement lié à une question d’ « humanitude », avertit Myriam Rasse, « si on veut cheminer vers une société humaine, ces métiers compliqués, [toutes ces professions relationnelles], devraient être beaucoup plus valorisés par la formation, les salaires et l’accompagnement indispensables. Il faut des espaces d’expression pour pouvoir arriver dans cette attention à l’autre, (…) être à l’écoute de ce qu’on ressent, ne pas mettre un mouchoir par-dessus. Prendre soin des soignant-e-s pour qu’elles-ils puissent prendre soin des personnes qu’ils-elles soignent. ».
Pour contacter le Collectif « Place des aînés », Aude Limet : collectifplacedesaines@protonmail.com
Pour aller plus loin :
– Humaniser le soin et cultiver l’autonomie, de la naissance à la fin de vie, (article) CEMÉACTION – Prendre soin – Septembre 2021
– Pourquoi étudier les vieillesses dans leur diversité ? (article), in The Conversation, 2019
– Maison de repos, maison de vie ? (ouvrage), Altura Edition, 2022
– Les mécanismes de l’âgisme, (capsule vidéo), Entr’âges asbl https://www.intergenerations.be/search_engine.php?search=publication
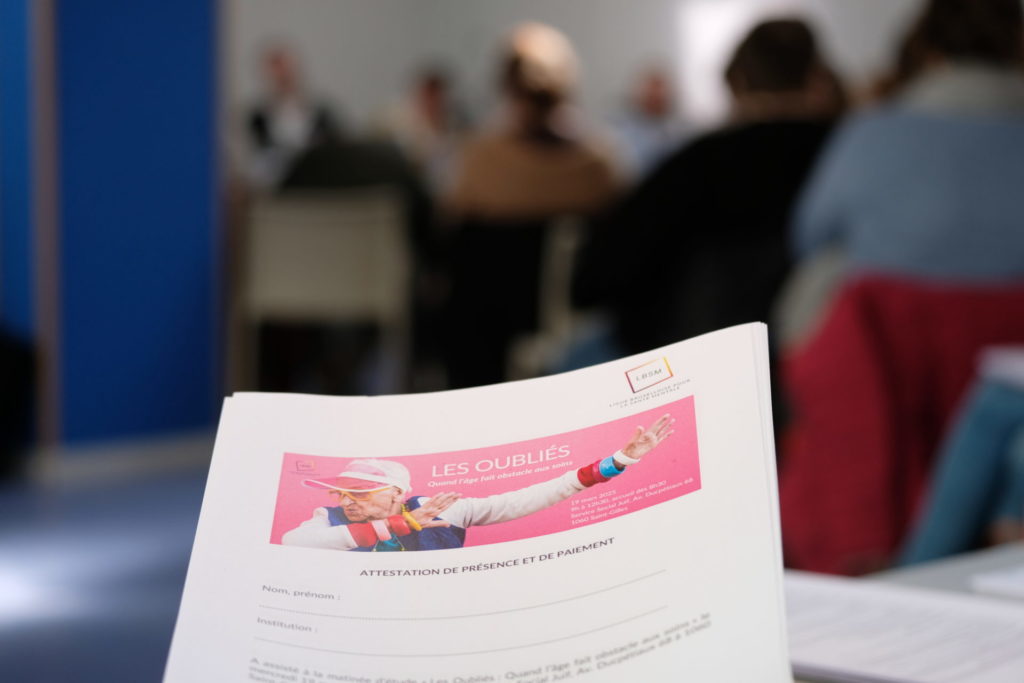
@Robin Susswein, pour la LBSM






