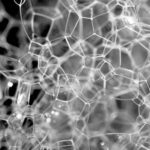« Sociétés en changement » (n°2) réalisé par l’Institut d’analyse du changement dans l’histoire et les sociétés contemporaines (IACCHOS) de l’Université catholique de Louvain, juin 2017.
Depuis les années 1970, le monde musulman est marqué par l’accroissement des référentiels religieux et des pratiques de piété. Cette affirmation religieuse s’accompagne de crispations identitaires et mène certains à la radicalité violente. En Europe, le malaise est devenu de plus en plus grand entre les communautés musulmanes et les sociétés occidentales qui les ont accueillies. Comment sortir du piège ? Comment construire une compréhension réciproque qui permette de construire des voies d’actions pour l’avenir ? Brigitte Maréchal, sociologue et islamologue, directrice du Centre interdisciplinaire d’études de l’islam dans le monde contemporain (CISMOC) de l’UCL, Felice Dassetto, sociologue, professeur émérite de l’UCL et membre de l’Académie royale de Belgique, ainsi que Abdessamad Belhaj, islamologue et politologue et Ghaliya Djelloul, sociologue au CISMOC proposent une lecture fouillée et éclairante des relations entre l’islam et l’Europe qui conduisent à interpeller les politiques publiques sur la nécessité de promouvoir enfin une co-inclusion sociale et civilisationnelle. Celle-ci nécessite que chacun comprenne la posture de l’Autre dans la construction de son propre jugement. A défaut, les forces de co-exclusion garderont le vent en poupe.Extrait choisi
Le musulman ordinaire – et ceci est une nouveauté – prend progressivement conscience de l’impasse de la pensée musulmane religieuse et politique. Des voix s’élèvent pour dénoncer certaines pratiques religieuses dépassées, questionner l’apostasie, la situation des femmes, de l’homosexualité, etc. Ces interpellations restent timides et ne trouvent guère encore d’échos auprès des responsables religieux, peu (auto-)critiques et/ou trop peu formés pour affronter ces questions complexes qui se posent avec une acuité nouvelle dans les sociétés plurielles. Par ailleurs, l’interprétation violente des textes sacrés musulmans pose un terrible défi aux autorités religieuses et figures intellectuelles musulmanes : auront-t-elles l’audace et la capacité de dépasser la simple dénonciation pour combattre les revendications religieuses des auteurs des attentats et l’idéologie djihadiste qui regorge de citations issues du corpus coranique et de la tradition prophétique ? Parviendront-elles à mobiliser aussi les apports des sciences sociales qui, avec leurs questionnements et leurs méthodes d’analyse permettraient une meilleure contextualisation du religieux ? Le politique, quant à lui, dispose de leviers sécuritaires et mobilise des politiques proactives, notamment lorsqu’il se dote d’un arsenal législatif et d’institutions pour lutter concrètement contre les discriminations. Mais n’affronterait-il pas mieux les défis de la multiculturalité et du radicalisme en revalorisant enfin toutes les structures de formation et d’enseignement, y compris supérieures ? Notamment pour mieux saisir l’histoire bouillonnante et complexe de la confrontation des idées et porter un regard critique sur la modernité politique et les démocraties libérales qui en ont émergé.Accès à l’intégralité de la réflexion en PDF ou via le site de IACCHOS.